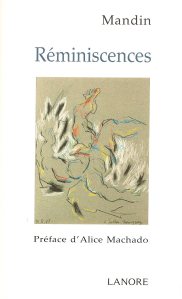

 http://www.youtube.com/user/MANDIN1947?feature=mhee
http://www.youtube.com/user/MANDIN1947?feature=mhee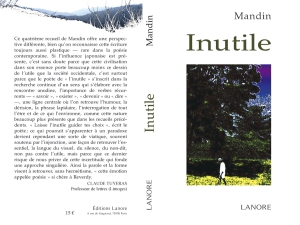
http://www.youtube.com/user/MANDIN1947?feature=mhee
Ce quatrième recueil de Mandin offre une perspective différente, bien qu’on reconnaisse cette écriture toujours aussi plastique – rare dans la poésie contemporaine. Si l’influence japonaise est présente, c’est sans doute parce que cette civilisation dans son essence porte beaucoup moins ce dessin de l’utile que la société occidentale, c’est surtout parce que le poète de « l’inutile » s’inscrit dans la recherche continue d’un sens qui s’élabore avec la rencontre anodine, l’importance de verbes récurrents – « savoir », « exister », « devenir » ou « dire » – , une ligne centrale où l’on retrouve l’humour, la dérision, la phrase lapidaire, l’interrogation de tout l’être et de ce qui l’environne, comme cette nature beaucoup plus présente que dans les recueils précédents. « Laisse l’inutile guider tes choix », écrit le poète ; ce qui pourrait s’apparenter à un paradoxe devient cependant une sorte de viatique, souvent soutenu par l’injonction, une façon de retrouver l’essentiel, la langue du visuel, du silence, du non-dit, non pas contre l’utile, mais parce que ce dernier risque de nous priver de cette incertitude qui fonde une approche singulière. Ainsi la parole et la forme visent à retrouver, sans hermétisme, « cette émotion appelée poésie » si chère à Reverdy.
CLAUDE TUYERAS Professeur de lettres
De Kyôto, après la lecture
le 16 novembre 2012.
Vous avez composé un long poème autour d’un seul thème avec de multiples images personnelles. Quelle aisance vous avez dans la poésie ! Quand vous mettez au début ce vers :
lorsque moi me dit : je … devient inutile
votre voyage vers une terre inconnue a déjà commencé. Vous dites être utile à vos « incertitudes », car c’est le lieu créateur de l’œuvre poétique et générateur de vie, lieu qui se trouve entre le “ moi ” et l’autre, l’utile et l’inutile, la vie et la mort, et celui que vous reconnaissez dans la différence éternelle de l’homme et de la femme. Vous ne prononcez pas ouvertement le je-sujet, mais ce n’est qu’une apparence. Vous êtes comme une toile d’araignée magnifiquement tissée. À travers cette toile, vous regardez, sentez, entendez et même touchez le dehors, l’autre. Cette image me suit tout au long du poème.
De la nature vous faites un microcosme original où le poète fait vagabonder l’imagination et libère l’esprit. Il n’est ni occidental ni oriental. Des sensations visuelles, auditives, tactiles et olfactives s’y expriment dans une fraîcheur et une intensité qui ont quelque chose d’originel. J’aime le caractère éthéré et vibrant de l’espace que vous développez dans cet univers de la nature, dans lequel tout retrouve une nouvelle signification, celle que vous lui accordez. Je cite :
l’ombre du platane
s’abat sur les rires d’enfants
l’ombre inutilement doit se tenir loin du soleil
les enfants la protègent de leurs beaux yeux crédules
audacieuse
l’ombre blessée du grand platane
part avec le premier nuage venu
sans leur dire merci
Le dynamisme des mouvements est apporté par le jeu de la lumière et de l’ombre. Dégagés de l’emprise du sujet, ces vers deviennent une expressivité pure. Grâce à l’image de vos yeux tournés vers le ciel, récurrente dans votre poème, vous conférez à la poésie un pouvoir créateur. Ainsi vous donnez une expression plastique à la sensation personnelle, synonyme d’émotion.
Par ailleurs les éléments de la nature comme les mousses, les oiseaux, les insectes, qui apparaissent à un rythme qui vous est propre, deviennent de nouveaux signes comme autant de métaphores d’une écriture. Le mouvement même d’une limace symbolise, me semble-t-il, la calligraphie qui naît sous votre plume.
Vous parlez du « Tao », pensez l’inutile et le silence. Se détacher des choses du monde en utilisant le langage de la vie de tous les jours, c’est ce qu’on appelle « Rizoku » au Japon dans le domaine du haïku. Si dans les métaphores de vos poèmes prolifèrent les oppositions, cela ne tient pas à la parole humaine, mais aux opacités de la vie. En revanche, si le haïku est lapidaire, c’est que ce poème est comme une coupe faite dans le courant du temps et dans l’étendue de l’espace. Malgré une telle différence au niveau de la perception et de l’expression, je trouve une similitude entre votre poème et le haïku : aucun poète, dans ce lieu où il fait entendre la voix qui est la sienne, n’est inutile, car recomposer le passé et le présent dans et par la poésie, c’est ciseler le silence et le vide pour faire apparaître dans l’avenir ce qui se dérobe à l’utile, bref une perception originelle du monde.
Il est sûr que votre lucidité poétique écarte les gracieusetés lyriques ou bien l’expression directe de souvenirs ou de repentirs, mais quand vous chantez, par exemple, l’été qui « a une odeur de vieille forge », votre poésie éveille en moi des souvenirs lointains : l’odeur minérale et le silence particulier que j’ai sentis dans l’école déserte dont les bâtiments projetaient sur le sol la silhouette de l’ombre et de la lumière. Je me rappelle également le sentiment vague des regrets au réveil d’une sieste d’été sur le « coutil » du lit « aux chaleurs salées ». C’est pourquoi, née de la sensibilité et de la sensation, votre poésie demeure, je trouve, profondément humaine.
À la fin du poème, le je-sujet apparaît à nouveau dans cette belle formule :
je est un soupçon
c’est-à-dire une ombre. L’ombre « meurtrie » que vous gardez toujours dans la paume de votre main et qui se cache dans chaque fibre de toute existence me semble être “ la naissance et la fin ” de ce poème.
Je viens de fermer la dernière page de votre livre. Je vous dédie ce haïku qui voudrait dire la joie que j’ai ressentie en lisant vos poèmes …
Ikuko Morita – Poète, enseignante à l’Université de Doshisha, Kyôto
****************
Ce troisième recueil de Mandin offre une perspective différente, bien qu’on reconnaisse cette écriture toujours aussi plastique – rare dans la poésie contemporaine. Si l’influence japonaise est présente, c’est sans doute parce que cette civilisation dans son essence porte beaucoup moins ce dessin de l’utile que la société occidentale, c’est surtout parce que le poète de « l’inutile » s’inscrit dans la recherche continue d’un sens qui s’élabore avec la rencontre anodine, l’importance de verbes récurrents – « savoir », « exister », « devenir » ou « dire » – , une ligne centrale où l’on retrouve l’humour, la dérision, la phrase lapidaire, l’interrogation de tout l’être et de ce qui l’environne, comme cette nature beaucoup plus présente que dans les recueils précédents. « Laisse l’inutile guider tes choix », écrit le poète ; ce qui pourrait s’apparenter à un paradoxe devient cependant une sorte de viatique, souvent soutenu par l’injonction, une façon de retrouver l’essentiel, la langue du visuel, du silence, du non-dit, non pas contre l’utile, mais parce que ce dernier risque de nous priver de cette incertitude qui fonde une approche singulière. Ainsi la parole et la forme visent à retrouver, sans hermétisme, « cette émotion appelée poésie » si chère à Reverdy.
***************
Je ne doute pas que mon impertinence « d’utiliser » René Char, surprendra plus d’un visiteur… mais si un poète doit laisser des traces (des poèmes comme les tesselles d’une mosaïque) il ne doit pas pour cela mettre ses traces dans les rêves d’un autre, fut-il son père, son mentor, se femme de ménage ou son pire ami. René Char est mon ami, mon amitié (dans un seul sens pour cause de décalage horaire ) s’est tissée en le lisant, nous nous sommes parlés, les poètes ont des silences qu’eux seuls peuvent entendre. Baudelaire et Eluard sont aussi mes amis, sans oublier Bach ; mais comme un bateau je ne suis pas amoureux des vagues, elles me portent, me dirigent et en fin de compte m’échouent. Capharnaüm est une brocante, le lecteur entre pour chercher… rien de particulier, rien de réel, une vieille émotion cabossée, une idée pour sourire. René Char n’a-t-il pas écrit dans les Feuillets d’Hypnos : « N’étant jamais définitivement modelé, l’homme est receleur de son contraire.».
La chute d’Icare comme réminiscence de nos vies passées.
En me souvenant de la mort d’un être cher, sa vie me ramena à la mienne et j’ai ainsi commencé un seul et long texte : Cartes postales découpées dans ce voyage de l’âme réminescente !
Au fur et à mesure de l’écriture les mots maculèrent des souvenirs à peine secs, qui n’ont peut-être jamais existé. Dont il n’a jamais été le témoin. En des voltiges icariennes, des souvenances se sont éparpillées en chutant dans ce livre ; j’ai chuté pour me taire… Pour taire les origines de nos histoires,faites de ruelles enchevêtrées, dont nous étions les frères, seulement. Dans cet oubli du souvenir, lui seul ne saura jamais de Qui est fait le silence. Seul le poète sait se taire… susurrement.
http://www.fernand-lanore.com/rayons/poesie.shtml ( Distribué en librairie: France, Suisse,Belgique. contact@editionslanore.com –
mm@mandin.com –
